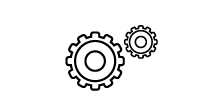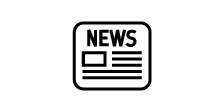Le bilinguisme augmente-t-il les capacités cérébrales ?
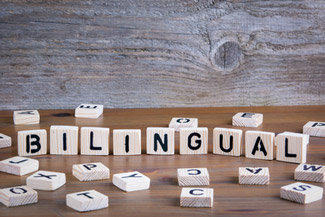 Depuis plusieurs années, J.-M. Annoni, professeur à l’Université de Fribourg (Suisse) et neurologue, a mené des études sur les effets du bilinguisme sur le cerveau. Dans une interview parue dans le journal suisse Le Matin, ce spécialiste du développement du langage nous éclaire sur les impacts de l’acquisition/apprentissage d’une deuxième langue sur le cerveau. Comment celui-ci parvient-il à gérer deux (ou plusieurs) langues ?
Depuis plusieurs années, J.-M. Annoni, professeur à l’Université de Fribourg (Suisse) et neurologue, a mené des études sur les effets du bilinguisme sur le cerveau. Dans une interview parue dans le journal suisse Le Matin, ce spécialiste du développement du langage nous éclaire sur les impacts de l’acquisition/apprentissage d’une deuxième langue sur le cerveau. Comment celui-ci parvient-il à gérer deux (ou plusieurs) langues ?Les études menées par J.-M. Annoni ont démontré combien notre cerveau pouvait être flexible en étant capable d’opter pour des stratégies différenciées selon les contextes dans lesquels il est sollicité. Par exemple, une personne parfaitement bilingue aura tendance à développer deux « modes de lecture » oculaires, selon que le mot à lire soit en français ou en allemand. Pour le premier, ses yeux se poseront plutôt au milieu, alors que pour le second, ce sera juste avant le début. La raison avancée tient à l’opacité de la langue française (une même lettre peut être prononcée différemment, d’où la nécessité d’appréhender le mot globalement pour savoir comment le lire) et à la transparence de l’allemand (chaque lettre équivaut à un son). Ainsi, la structure d’une langue peut commander au cerveau sa manière de lire.
Bilingue lui-même (français et italien), J.-M. Annoni explique que le cerveau monolingue et le cerveau bilingue sont, quelle que soit la langue, à peu près identiques. Une différence s’opère cependant au moment de l’apprentissage d’une deuxième langue, pour lequel le cerveau a besoin de plus d’espace. Dans ce cas, des structures dans l’hémisphère droit vont être sollicitées. Or, on sait depuis longtemps que le langage se concentre essentiellement dans l’hémisphère gauche (avec les zones clés que sont l’aire de Wernicke pour la compréhension des mots et l’aire de Broca pour la production). Une fois cette deuxième langue apprise, cet espace supplémentaire n’est plus « utile ». Grâce à l’imagerie fonctionnelle, un système de contrôle pour inhiber la ou les langues non utilisée(s) au moment où une personne s’exprime a été mis en évidence. Celui-ci n’est du reste pas spécifique au langage mais à nos actions en général.
De plus, selon l’âge et la manière dont la deuxième langue est acquise (en immersion) ou apprise (à l’école), l’organisation cérébrale diffère. En fait, une bonne maitrise de cette deuxième langue favorise son automatisation, et dans ce cas, les mêmes structures que celles sollicitées pour la première langue se retrouvent.
En ce qui concerne les avantages du bilinguisme, J.-M. Annoni indique qu’: « être bilingue augmente les réserves cognitives, ce qui va dans le sens d’une plus grande flexibilité intellectuelle ou plasticité cérébrale ». Mais il ajoute que cette optimisation est tout aussi effective chez une personne qui développe un intérêt particulier dans tel ou tel autre domaine. Le neurologue signale également que les premiers effets de la maladie d’Alzheimer sont en général plus lents à se faire sentir (de 6 mois à 2 ans) chez une personne bilingue par rapport à une monolingue.
Pour finir, le professeur va aussi à l’encontre de cette idée reçue ; à savoir qu’il existerait un âge limite pour apprendre une langue étrangère. Au contraire, les études semblent démontrer que, même tardif, cet apprentissage serait bénéfique pour le cerveau. Il dresse le parallèle avec la pratique d’un instrument de musique ou toute autre activité « stimulante ».
Source : interview de Jean-Marie Annoni par Elodie Lavigneen « Le bilinguisme augmente les réserves cognitives », pour Le Matin (23-07-2017) Buetler KA, de León Rodríguez D, Laganaro M, Müri R, Spierer L, Annoni JM., “Language context modulates reading route : an electrical neuroimaging study”, in Frontiers in Human Neuroscience, février 2014