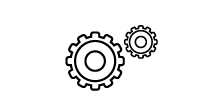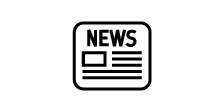Le goût du risque est-il contagieux ?
 « Tapis ! » Peut-être n’auriez-vous pas osé prendre une décision aussi audacieuse si vous n’étiez pas entouré, à la table de poker, de joueurs ayant le goût du risque ? En effet, ce dernier serait potentiellement « transmissible », même à des personnes timorées, en raison de mécanismes cérébraux stimulant l’effet de « contagion comportementale ». Pourquoi a-t-on tendance à prendre davantage de risques au contact de personnes plus téméraires que soi ?
« Tapis ! » Peut-être n’auriez-vous pas osé prendre une décision aussi audacieuse si vous n’étiez pas entouré, à la table de poker, de joueurs ayant le goût du risque ? En effet, ce dernier serait potentiellement « transmissible », même à des personnes timorées, en raison de mécanismes cérébraux stimulant l’effet de « contagion comportementale ». Pourquoi a-t-on tendance à prendre davantage de risques au contact de personnes plus téméraires que soi ?
Pour étudier ce possible effet de contagion du goût du risque, les chercheurs de l’université de Caltech, en Californie, ont mis au point une expérience de simulation de pari pour étudier les comportements de 24 participants. Trois types de processus ont été élaborés. Premièrement, un processus « observation », dans lequel il s’est agi d’observer le comportement de prise de risque d’un pair. Deuxièmement, un processus « prédiction » dans lequel le participant a dû prévoir les tendances d’un pair observé, sans avoir d’informations sur la réussite ou non d’une prise de risque. Troisièmement, le processus « soi-même » pour lequel on a demandé à la personne de choisir, en 4 secondes maximum, entre un pari sûr mais peu rémunérateur (10$) ou une prise de risque beaucoup plus élevée avec à la clef un gain plus important.
Qu’ont observé J. O’Doherty et ses collègues ? Que les participants sont bien plus enclins à faire un pari plus risqué dans le processus « soi-même », quand ils ont déjà observé un pair qui prenait des risques. Cet effet de contagion fonctionne aussi dans l’autre sens, dans la mesure où un participant qui a observé un pair plus prudent, va adopter un comportement semblable quand il aura à choisir lui-même. Selon S. Suzuki, chercheur postdoctoral en neuroscience, en observant des personnes qui ont le goût du risque, ou qui au contraire, ne l’ont pas, « nous devenons à notre tour plus ou moins sujets à des comportements à risques. » Cela signifie que la prise (personnelle) de risque peut être modifiée par l’acte d’observer et d’apprendre des décisions des autres.
Afin de détecter d’éventuelles régions spécifiques du cerveau liées à cette prise de risque, l’équipe de chercheurs a utilisé l’IRM fonctionnelle (IRMf). L’activité cérébrale des participants a été examinée pendant les différentes phases de l’expérience. L’équipe de J. O’Doherty a alors déterminé que la région du noyau caudé était associée à l’évaluation et à la prise de risque. Par exemple, un pari audacieux donne lieu à une activité plus élevée dans cette zone cérébrale qu’un pari peu risqué. De plus, les données IRMf recueillies lors du processus « observer » ont montré qu’une autre partie du cerveau, le cortex préfontal dorsolatéral, était active lorsque les participants prenaient connaissance des comportements des pairs à l’égard du risque. Ces deux régions du cerveau fonctionnent en quelque sorte ensemble pour rendre une personne plus ou moins sensible à la contagiosité de la prise de risque.
Les résultats de cette étude, publiée dans le Proceedings National Academy of Sciences (PNAS), font partie d’un objectif plus global, dans lequel les chercheurs essaient de déterminer comment nous pouvons apprendre des autres en société. Selon J. O’Brien : « si nous pouvons comprendre comment notre cerveau fonctionne dans des situations sociales, cela devrait également nous permettre de mieux comprendre comment les circuits du cerveau peuvent aller de travers, faire la lumière sur l’anxiété sociale, l’autisme et autres troubles sociaux. »
Source : S. Suzuki, E. L-S Jensen, P. Bossaerts & J.P. O’Doherty, Behavioral contagion during learning about another agent’s risk-preferences acts on the neural representation of decision-risk, in PNAS, 21-03-2016.