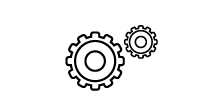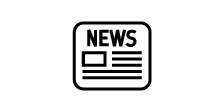Les mots peuvent-ils influencer la dilatation de nos pupilles ?
 Selon la lumière ambiante ou selon notre humeur, on sait que nos pupilles se dilatent (on appelle cela la mydriase) ou se contractent (la myosis). Une récente étude menée par des chercheurs du Laboratoire de psychologie cognitive (Université Aix-Marseille), du Laboratoire parole et langage (id.) et de l’Université de Groningen (Pays-Bas), démontre que le sens d’un mot influencerait aussi la taille de nos pupilles. Comment un mot peut-il déclencher une dilatation ou une rétraction des pupilles ?
Selon la lumière ambiante ou selon notre humeur, on sait que nos pupilles se dilatent (on appelle cela la mydriase) ou se contractent (la myosis). Une récente étude menée par des chercheurs du Laboratoire de psychologie cognitive (Université Aix-Marseille), du Laboratoire parole et langage (id.) et de l’Université de Groningen (Pays-Bas), démontre que le sens d’un mot influencerait aussi la taille de nos pupilles. Comment un mot peut-il déclencher une dilatation ou une rétraction des pupilles ?
Dans les années 70, Eckward Hess, pionnier de la pupillométrie (et ancien directeur du département de Psychologie de l’Université de Chicago), avait observé qu’en général, la taille des pupilles augmente lorsqu’une personne observe quelque chose ou quelqu’un de « stimulant ». Les publicités pour les cosmétiques ont d’ailleurs bien pris en compte le fait que les yeux sont un élément clé de la séduction. En effet, dans celles-ci, vous pouvez constater que les égéries (hommes ou femmes) présentent toujours des pupilles très dilatées (photoshop se chargeant le plus souvent d’accentuer ce trait). L’industrie du jouet a, elle aussi, su mettre à profit cette découverte ; il suffit de regarder le nombre de poupées et autres figurines aux pupilles surdilatées proposées sur le marché.
Loin de ces considérations commerciales, la présente étude s’inscrit dans les théories de l’incarnation de la langue. Elles reposent sur le fait que lorsque des personnes traitent la signification d’un mot (qui se réfère à des actions ou des objets concrets), elles simulent mentalement l’entrée sensorielle associée. Concrètement, lorsqu’on lit le mot « clavier », on simule mentalement une action de frappe ou pour le mot « soleil », on se représente la perception d’une boule de feu brillante dans le ciel. Certaines de ces théories, qui se fondent sur une forte réalisation de la langue, affirment que de telles simulations sont nécessaires à la compréhension.
Dans la recherche actuelle, il s’agissait de montrer que si la compréhension d’un mot active les zones cérébrales connues pour être impliquées dans le traitement de l’information visuelle non linguistique (c’est-à-dire des représentations sensorielles), alors comprendre des mots qui incarnent un sentiment de luminosité ou d’obscurité pourrait déclencher des réponses pupillaires. Pour tester cette hypothèse, les scientifiques français et néerlandais ont mené deux expériences dans lesquelles les participants ont lu ou écouté des mots qui évoquent la luminosité (ex : jour, illuminé, briller) ou l’obscurité (ex : nuit, foncé, sombre) ou bien des mots neutres (ex : maison, lapin). La taille de leurs pupilles a alors été mesurée. 30 sujets (21 femmes, 9 hommes, 18-54 ans) ont suivi l’expérience visuelle, 30 autres (19 femmes, 11 hommes, 18-31 ans) ont suivi l’expérience auditive et 30 observateurs ont participé à l’expérience de contrôle (mots neutres). Quels sont les résultats ?
Les chercheurs ont observé que la taille des pupilles variait selon la luminosité sémantique des mots. Ainsi, les pupilles se rétractent quand les participants lisent ou écoutent des mots qui transmettent de la luminosité et se dilatent quand il s’agit de mots qui évoquent l’obscurité. Cet effet n’est pas lié aux propriétés visuelles ou auditives des stimuli, ce qui suggère que le sens des mots est suffisant pour déclencher une réponse pupillaire.
Ces résultats ouvrent une nouvelle voie pour comprendre davantage le traitement du langage par notre cerveau. La compréhension des mots passent-elles nécessairement par l’élaboration d’images mentales ou celles-ci ne sont-elles qu’une conséquence indirecte du traitement du langage (un réflexe du système nerveux lié à la situation évoquée par un mot) ? Face à ces interrogations, les chercheurs vont poursuivre leur expérience, en testant notamment leur hypothèse sur d’autres langues.
Source : Sebastiaan Mathôt, Jonathan Grainger, Kristof Strijkers, « Pupillary Responses to Words That Convey a Sense of Brightness or Darkness », in Psychological Science, 14 juin 2017.