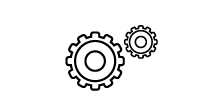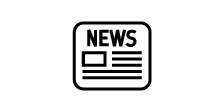Les très jeunes enfants savent-ils quand ils ne savent pas ?
 Jusqu’à aujourd’hui, la métacognition (la faculté à réfléchir sur ses propres pensées ou actions) était considérée comme quasi inexistante chez les enfants de moins de 6-7 ans. Une étude récente révèle que dès 20 mois, les bébés sont capables d’exprimer (non verbalement) leurs propres incertitudes. Comment les chercheurs sont-ils parvenus à contourner l’obstacle d’un langage mal maîtrisé pour démontrer cette faculté de réflexivité chez les très jeunes enfants ?
Jusqu’à aujourd’hui, la métacognition (la faculté à réfléchir sur ses propres pensées ou actions) était considérée comme quasi inexistante chez les enfants de moins de 6-7 ans. Une étude récente révèle que dès 20 mois, les bébés sont capables d’exprimer (non verbalement) leurs propres incertitudes. Comment les chercheurs sont-ils parvenus à contourner l’obstacle d’un langage mal maîtrisé pour démontrer cette faculté de réflexivité chez les très jeunes enfants ?
La capacité de métacognition nous permet d’acquérir de nouvelles informations de manière optimale, en adaptant nos stratégies d’apprentissage en fonction de notre état actuel des connaissances. De ce fait, il a été démontré que la métacognition était un prédicteur important de l’apprentissage. Chez les enfants d’âge préscolaire, évaluer les capacités métacognitives nécessite de mettre au point un protocole qui ne sollicite pas la verbalisation.
Dans l’étude réalisée par l’équipe Cerveau et Conscience, du laboratoire de sciences cognitives et psycholinguistique (CNRS/ENS/EHESS), publiée dans la revue médicale américaine PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences), les scientifiques français relatent l’expérience suivante : ils ont demandé à 80 bébés (âge moyen = 20.17 mois) de mémoriser l’emplacement d’un jouet caché à leur vue sous une des deux boîtes présentées devant eux. Après des délais variables pendant lesquels les boîtes étaient placées derrière un rideau noir (durant 3, 6, 9 ou 12 secondes), les bébés devaient pointer la boîte dans laquelle ils pensaient trouver le jouet. Mais il y avait un cinquième niveau de difficulté, où les boîtes étaient directement dissimulées derrière un rideau opaque, rendant impossible la résolution du test. Ces manipulations avaient pour but de permettre de vérifier si les nourrissons pouvaient surveiller et communiquer leur propre incertitude (notamment pour les longs délais de mémorisation et les essais impossibles).
Qu’ont observé les chercheurs ?
Par rapport à un groupe témoin, dans lequel les bébés n’avaient pas d’autre choix que de décider par eux-mêmes, les enfants du groupe expérimental, qui ont eu la possibilité de demander de l’aide par la communication non verbale (quand ils avaient oublié l’emplacement du jouet), ont utilisé cette option stratégique pour pointer la bonne boîte. Cela démontre que les nourrissons savent quand ils ne savent pas, qu’ils le manifestent, et qu’ils partagent cette information pour atteindre un objectif. De plus, la difficulté des tâches a eu un impact sur la probabilité de demander de l’aide. Celle-ci est plus élevée pour les essais impossibles que pour les essais possibles, et pour ceux-ci, elle augmente avec les délais de mémorisation. Autre résultat intéressant, les bébés ont généralisé leur demande d’aide même pour les essais possibles, afin d’améliorer leur performance. Enfin, le fait que les enfants du groupe témoin n’aient pas demandé spontanément de l’aide, quand ils étaient incertains, indique qu’ils avaient besoin d’être avertis de cette possibilité. Il n’en demeure pas moins que 35% des enfants du groupe expérimental n’ont pas profité de cette aide. Cette différence de comportement reflète les différences dans la capacité métacognitive, avec notamment des enfants qui ont tendance à surestimer leurs capacités.
D’autres facteurs tels que les fonctions exécutives et l’attachement parental (le parent étant l’aidant dans cette expérience) jouent possiblement un rôle dans les différences interindividuelles observées dans les capacités métacognitives et les comportements de recherche d’aide.
Pour conclure, les chercheurs suggèrent que leurs résultats mettent en lumière « l’utilité de la métacognition explicite, non seulement pour la coopération, mais aussi pour apprendre des autres. »
Source : Louise Goupila, Margaux Romand-Monniera et Sid Kouidera, Infants ask for help when they know they don’t know, PNAS, janvier 2016.