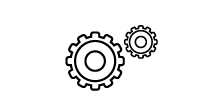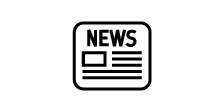Pour les jeunes enfants, le pouvoir est-il féminin ou masculin ?
 Généralement, les représentations sociales associent les hommes avec un pouvoir plus élevé que les femmes. Mais qu’en est-il de ces représentations (que l’on peut déplorer) chez les enfants ? La présente recherche avait justement pour objectif de cerner leur émergence auprès de sujets d’âge préscolaire, dans différents pays. Les jeunes enfants attribuent-ils plus de pouvoir aux hommes ou aux femmes ? Résumé de cette étude.
Généralement, les représentations sociales associent les hommes avec un pouvoir plus élevé que les femmes. Mais qu’en est-il de ces représentations (que l’on peut déplorer) chez les enfants ? La présente recherche avait justement pour objectif de cerner leur émergence auprès de sujets d’âge préscolaire, dans différents pays. Les jeunes enfants attribuent-ils plus de pouvoir aux hommes ou aux femmes ? Résumé de cette étude. Les chercheuses et chercheurs de l’Institut des sciences cognitives Marc Jeannerod (CNRS/Université Claude Bernard Lyon 1), en collaboration avec les universités d’Oslo (Norvège), de Lausanne et de Neuchâtel (Suisse) ont mené trois expériences.
Dans la première, ils ont montré à plus de 400 enfants (âgés de 4 à 6 ans) de France, du Liban et de Norvège une image où figuraient deux personnages non genrés. Chez l’un, on pouvait observer une posture physique de dominance et chez l’autre, une posture de subordination. Tout d’abord, les expérimentateurs ont demandé aux jeunes participants de deviner quel personnage exerçait du pouvoir sur l’autre. Ensuite, ils devaient dire qui était la fille et qui était le garçon. Les résultats indiquent qu’à partir de 4 ans, une forte majorité d’enfants ont fortement associé le pouvoir au caractère masculin. Cette association a par ailleurs été relevée aussi bien chez les garçons que chez les filles ; et dans tous les pays cités plus haut.
Dans la deuxième expérience, des enfants de 4-5 ans (nb = 160 ; cette fois tous scolarisés en France), devaient se projeter eux-mêmes dans l’image et imaginer que l’autre personnage était soit une fille soit un garçon. Dans le cas de figure où les jeunes participants devaient envisager sa relation de pouvoir avec un personnage du même genre qu’eux, les garçons tout comme les filles s’identifiaient davantage au personnage à la posture dominante. Mais dans le cas de figure contraire, c’est-à-dire dans un contexte mixte, si les garçons n’ont pas varié leur point de vue (ils ont choisi d’incarner majoritairement le personnage dominateur), les filles se sont montrées significativement moins promptes à le faire. A vrai dire, elles ne s’identifiaient pas davantage à l’un ou à l’autre des personnages.
Dans la dernière expérience réalisée auprès de 213 enfants (4-5 ans) de France et du Liban, les scientifiques ont présenté au sujet une série d’échanges entre deux marionnettes, l’une représentant une fille et l’autre un garçon. Celles-ci ont été montrées aux enfants avant d’être dissimulées derrière une planche. Elles ont été manipulées par le même orateur et les voix pour les deux personnages étaient les mêmes. Dans une saynète, les marionnettes s’apprêtaient à jouer ensemble et les enfants entendaient l’une imposer ses choix à l’autre. Dans une autre saynète, l’un des personnages avait plus d’argent que l’autre pour acheter des glaces. Voici un exemple de dialogue ci-dessous :
Regarde il y a deux enfants :
Un enfant dit : « Tu dois faire tout ce que je te dis ! Fais ce que je veux ! »
Et l’autre enfant répond : « D’accord je fais tout ce que tu veux »
Qui est la fille ? Qui est le garçon.
Les résultats montrent que les garçons considéraient que la marionnette qui imposait ses choix ou qui détenait le plus d’argent était masculine. Quant aux filles des deux pays, comme précédemment, elles n’ont pas marqué de préférence.
Ainsi, de façon précoce, les enfants associent le pouvoir à la masculinité, même si selon les situations, les filles n’affichent pas de hiérarchie entre les genres. Contrairement aux garçons…
Source : Rawan Charafeddine, Imac Maria Zambrana, Benoît Triniol, Hugo Mercier, Laurence Kaufmann, Anne Reboul, Francisco Pons, Jean-Baptiste Van der Henst « How Preschoolers Associate Power with Gender in Male-Female Interactions: A Cross-Cultural Investigation. », in Sex Roles, ljanvier 2020 // Site du CNRS : « Les enfants, dès 4 ans, envisagent plus le pouvoir au masculin qu’au féminin » - http://www.cnrs.fr/fr/les-enfants-des-4-ans-envisagent-plus-le-pouvoir-au-masculin-quau-feminin