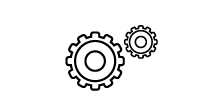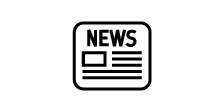Comment une grosse frayeur peut-elle nous faire cauchemarder ?
 Cela vous est-il déjà arrivé de faire des cauchemars après avoir vécu dans la journée un événement qui vous a apeuré ? Des chercheurs de l’Institut de Neuroscience (Université de New-York) ont étudié les mécanismes de ce processus de réactivation de la mémoire émotionnelle. Ils ont mené une expérience sur des rats à qui ils ont fait vivre une expérience inoffensive à l’aide d’un nettoyeur de clavier d’ordinateur… Alors, pourquoi cauchemardons-nous après avoir vécu une situation effrayante ?
Cela vous est-il déjà arrivé de faire des cauchemars après avoir vécu dans la journée un événement qui vous a apeuré ? Des chercheurs de l’Institut de Neuroscience (Université de New-York) ont étudié les mécanismes de ce processus de réactivation de la mémoire émotionnelle. Ils ont mené une expérience sur des rats à qui ils ont fait vivre une expérience inoffensive à l’aide d’un nettoyeur de clavier d’ordinateur… Alors, pourquoi cauchemardons-nous après avoir vécu une situation effrayante ?Tout comme peuvent le faire les humains, les rats stockent ce qu’on appelle des cartes cognitives. C’est en 1948 que ce terme a été introduit par E.C. Tolman qui soutenait que ces rongeurs n’apprenaient pas simplement des réponses (tourner à droite ou à gauche ; monter ou descendre) mais étaient capables de construire des cartes mentales de leur environnement ; c’est-à-dire du monde qu’ils éprouvent. Les différents contextes rencontrés sont traités par différents groupes de neurones de l’hippocampe. Afin de consolider la mémoire et un stockage à long terme, un mécanisme similaire se déroule pendant leur sommeil. Bien évidemment, un procédé de même nature se produit chez l’homme, bien qu’il n’ait été expliqué que depuis peu (voir notamment les travaux de l’équipe de A. Schapiro de la Harvard Medical School).
L’équipe de recherche composée de G. Girardeau, I. Inema et G. Buzsaki, ont voulu savoir si ces cartes mentales pouvaient également inclure les ressentis de l’animal ; plus particulièrement la peur. Ils ont alors mis en place l’expérience suivante : ils ont placé des rats dans un labyrinthe et à un endroit précis, ils leur ont envoyé une bouffée d’air sur la face (à l’aide d’un nettoyeur de clavier d’ordinateur). Bien qu’indolore, cela représente une expérience désagréable et éprouvante pour les rongeurs, qui, par la suite, au moment de passer à l’endroit fatidique, ralentissent puis fuient très rapidement. Alors que les rats avaient cartographié ce passage, les scientifiques ont enregistré des ensembles neuronaux dans l’hippocampe et l’amygdale basolatérale. Même observation durant leur sommeil. Concrètement, lorsque les rats vont se coucher, le centre de la peur dans leur cerveau se réactive et ils « revivent » ce passage inquiétant dans le labyrinthe.
Cette étude démontre que nos souvenirs ne sont pas uniquement des informations, mais que celles-ci sont liées à tout un contexte émotionnel. Evidemment, rien ne dit que les rats ont cauchemardé, mais comme le soulignent les auteurs de l’étude : « si la même chose se passe dans la tête des gens, cela pourrait conduire à des cauchemars, dans la mesure où un traumatisme favorise les mauvais rêves. »
Source : G. Girardeau, I. Inema et G. Buzsaki, « Reactivations of emotional memory in the hippocampus-amygdala system during sleep », in Nature Neuroscience, sept. 2017