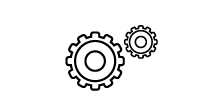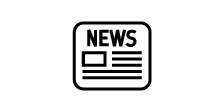Comment une oeuvre d'art nous émeut-elle ?
 Vous est-il déjà arrivé d’être saisi(e) d’émotion devant un tableau ou encore parcouru(e) de frissons à l’écoute d’un morceau de musique ? C’est à ces questions que dans son livre La Beauté dans le cerveau (Odile Jacob), Jean-Pierre Changeux essaie d’apporter des éléments de réponse. Interviewé pour L’Obs, le neurobiologiste revient sur l’apport des recherches dans le domaine des « neurosciences de l’art » à la compréhension de l’émotion esthétique. Que se passe-t-il dans notre cerveau quand nous sommes en présence d’une œuvre artistique ?
Vous est-il déjà arrivé d’être saisi(e) d’émotion devant un tableau ou encore parcouru(e) de frissons à l’écoute d’un morceau de musique ? C’est à ces questions que dans son livre La Beauté dans le cerveau (Odile Jacob), Jean-Pierre Changeux essaie d’apporter des éléments de réponse. Interviewé pour L’Obs, le neurobiologiste revient sur l’apport des recherches dans le domaine des « neurosciences de l’art » à la compréhension de l’émotion esthétique. Que se passe-t-il dans notre cerveau quand nous sommes en présence d’une œuvre artistique ?
L’ouvrage de J.P. Changeux, professeur honoraire au Collège de France, se présente comme une synthèse d’une vingtaine d’années de recherche, en particulier sur les mécanismes neuronaux mis en œuvre dans la perception esthétique. S’agissant d’un morceau de musique, notre cerveau distingue plusieurs composantes (la mélodie, l’harmonie, le rythme et l’émotion déclenchée) qui mobilisent chacun des traitements spécifiques. S’agissant d’un tableau (mais plus largement des arts visuels), son exploration par le regard va déterminer des « centres de signification » (par l’intermédiaire des couleurs, des formes, du mouvement). Par impulsions nerveuses, ces divers stimuli et l’information associée sont transmis au thalamus, puis au cortex cérébral où ils sont répartis dans différentes aires spécialisées, pour y être analysées.
J.P. Changeux et son collègue Stanislas Dehaene (son ancien étudiant), ont analysé ce qu’il se passait ensuite dans ce qu’ils ont nommé « l’espace de travail neuronal conscient », c’est-à-dire le lieu où va s’élaborer une recomposition intérieure (de l’œuvre perçue) à laquelle viennent se combiner, de manière instantanée, nos représentations, nos souvenirs. C’est grâce à des neurones particuliers aux axones très longs, qui sont capables de relier des zones distantes dans notre cerveau, que ce travail de synthèse personnelle peut se réaliser. Ainsi, lorsque nous contemplons un tableau, l’accès d’une perception donnée à la conscience correspond à une forme spécifique d’« ignition », terme employé par les deux neuroscientifiques pour définir l’embrasement soudain de « l’espace de travail neuronal conscient ». Mais en quoi cette « ignition » serait-elle spécifique ? J.P. Changeux émet l’hypothèse que « la valeur émotionnelle d’une œuvre d’art, ainsi que son pouvoir évocateur, entraînent un embrasement extraordinaire qui envahit notre espace conscient […] on peut imaginer une ignition explosive de la conscience, unissant système visuel, cortex préfrontal – le siège de la rationalité – et système limbique – le siège des émotions primaires ».
Ainsi, ce qui explique qu’un même tableau ou qu’une même œuvre musicale peut laisser « froids » certains et provoquer un choc émotionnel chez d’autres, c’est que toute expérience esthétique dépend du vécu de chacun (les éléments stockés dans la mémoire à long terme) mais aussi du moment donné (les multiples éléments contextuels). De ce fait, il est aussi rare qu’une œuvre entraîne deux fois la même réaction chez nous.
Si J.P. Changeux indique que la « définition neurobiologique du beau » reste à trouver, concluons cet article sur la compréhension de l’émotion esthétique par cette citation d’Oscar Wilde, que les recherches de J.P. Changeux attestent scientifiquement : « La beauté est dans les yeux de celui qui regarde ».
Source : http://bibliobs.nouvelobs.com/idees/20161208.OBS2373/ce-que-l-art-fait-a-notre-cerveau.html (interview de J.P. Changeux par V. Radier).