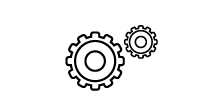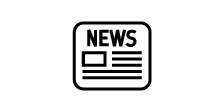Le piège cognitif du bachotage
 Lorsqu’au joli mois de mai fleurissent les rhododendrons, une fleur plus vénéneuse envahit les foyers, le bachotage… Que celui qui n’a jamais bachoté lève la main ! À ma connaissance, je ne crois pas être jamais tombé dans ce piège cognitif pourtant si répandu. Sans doute parce que j’étais trop angoissé pour prendre le risque de rater mes examens en attendant le dernier moment pour travailler.
Lorsqu’au joli mois de mai fleurissent les rhododendrons, une fleur plus vénéneuse envahit les foyers, le bachotage… Que celui qui n’a jamais bachoté lève la main ! À ma connaissance, je ne crois pas être jamais tombé dans ce piège cognitif pourtant si répandu. Sans doute parce que j’étais trop angoissé pour prendre le risque de rater mes examens en attendant le dernier moment pour travailler.
Et pourtant, le bachotage ça marche, puisque la plus grande partie des étudiants qui bachote réussit ses examens. Malheureusement, si cette période d’apprentissage soutenu se révèle efficace sur l’instant, trois mois après la réussite de l’examen, force est de constater que près de 90 % de ce qui a été appris, a été oublié.
Le bachotage, tous les atouts pour un échec cognitif !
Pourquoi le bachotage ne permet-il pas de conserver la trace de cette mémorisation intensive ? Les conditions néfastes dans lesquelles est réalisé le bachotage l’expliquent :
- trop de cours à mémoriser puisqu’ils se sont accumulés pendant six mois…
- il en découle un apprentissage rapide et superficiel ;
- pas suffisamment de répétitions des apprentissages, or il semble que la meilleure chance de retenir une information soit de l’apprendre entre cinq à sept fois ;
- pas d’espacement des répétitions car une « fenêtre d’oubli » est requise entre deux apprentissages. Cet intervalle idéal varie d’une personne à l’autre d’une à six semaines ;
- abus d’excitants de toutes sortes afin de renforcer la vigilance et la concentration (café, nicotine…), or ceci crée une vigilance artificielle qui ne facilite pas une mémorisation naturelle ;
- pour réussir à apprendre une grande quantité de cours, les étudiants empiètent sur leur temps de sommeil naturel, ce qui empêche la consolidation des données lors des phases du sommeil ;
- enfin, le stress affaiblit la mémorisation puisque les étudiants sont paniqués devant la tâche colossale de devoir rattraper six mois d’insouciance.
Que conseiller aux étudiants ?
Il n’existe bien sûr aucune méthode miraculeuse. On peut néanmoins donner quelques conseils : - accepter déjà que la mémoire est inégale : certaines personnes apprennent plus vite et mieux que d’autres, tout comme certains individus courent plus vite que d’autres. Comme en toutes choses biologiques, la mémoire est sélective et inégale ;
- tout d’abord, être motivé pour ses études. Sans motivation, il y a peu de chance qu’on puisse mémoriser facilement un cours, ceci est facile à comprendre depuis que l’on sait que les circuits d’apprentissage passent par les régions cérébrales impliquées dans la motivation (gyrus cingulaires) ;
- apprendre régulièrement, et ce dès la rentrée universitaire ;
- apprendre au moins cinq à sept fois ses cours, une première fois le soir même, puis une semaine plus tard et ensuite une fois par mois environ ;
- même s’il est important de bien comprendre ce qu’il faut retenir, de nombreux points doivent être appris par cœur car comprendre ne suffit pas. Il n’existe aucun métier pour lequel il ne soit pas nécessaire d’apprendre par cœur certains points ;
- pour mieux comprendre, il faut savoir. C’est le cercle vertueux de la mémoire : plus on sait, et mieux on apprend et plus on retient. Comme disait Picasso « la peinture, c’est comme le chinois, ça s’apprend ! » ;
- reformuler avec ses propres mots plutôt que d’apprendre « bêtement » les phrases du professeur. Ce qui est personnalisé est toujours mieux retenu ;
- utiliser une hiérarchie personnelle des paragraphes et favoriser les repères en soulignant les titres d’une couleur et les intertitres d’une autre ;
- faire des fiches qui résument les éléments importants des cours. Il faut s’astreindre à les consulter régulièrement ; - éventuellement, relire son cours avant de se coucher pour être certain de l’avoir bien compris. On sait en effet que chez les jeunes, ce qui a été appris juste avant de se coucher sera mieux retenu, alors que les personnes plus âgées subissent le soir l’effet contrariant de la fatigue ;
- le sommeil est une des clés de la consolidation car pendant la nuit s’opère un phénomène de « replay » des informations apprises dans la journée. Les circuits neuronaux activés durant la journée sont réactivés lors de certaines phases du sommeil, ce travail de révision et d’assimilation s’accompagne en outre d’un travail de classement des informations ;
- réciter son cours à voix haute à une tierce personne ;
- éviter les « impasses » qui créent du stress ;
- éviter d’apprendre avec en fond, la télévision ou des variétés françaises dont les paroles en français interfèrent avec les paroles françaises des cours. Ceci explique peut-être pourquoi les étudiants préfèrent, sans doute intuitivement, apprendre un cours sur fond de variétés anglo-saxonnes. Ce qui est clair, c’est que lorsque j’étais étudiant, je préférais apprendre mes cours sur fond de Verdi ou de Wagner que de Gounod ou de Bizet.
Ne pensez pas qu’il suffit maintenant de faire lire ce billet à vos enfants ou petits-enfants étudiants, l’expérience prouve qu’ils ne croient jamais les anciens et ne suivent pas leurs conseils. Ah, si jeunesse savait…
Source : Pour en savoir plus : Bernard Croisile. Tout sur la mémoire. Éditions Odile Jacob (2009).