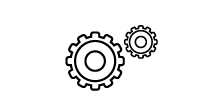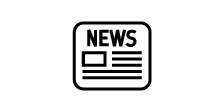Maman, j'oublie !
 Il n’y a rien de plus courant pour un spécialiste de la mémoire que d’être interrogé par des adultes anxieux sur l’âge des premiers souvenirs. Comprendre la mémoire des enfants est d’un grand intérêt pour déchiffrer celle des adultes. La mémoire d’un enfant se construit au fil du temps, mais alors qu’on devrait s’émerveiller de la rapidité avec laquelle il maîtrise en grandissant, la mémoire des gestes (mémoire procédurale), des concepts (mémoire sémantique) et des mots (langage), l’adulte qu’il sera devenu s’inquiètera un jour de l’absence de souvenirs de sa petite enfance. Les souvenirs correspondent à une autre forme de mémoire, dite mémoire épisodique, qui nous permet de nous rappeler les moments vécus une fois, précisément datés et localisés, et en outre teintés d’émotion.
Il n’y a rien de plus courant pour un spécialiste de la mémoire que d’être interrogé par des adultes anxieux sur l’âge des premiers souvenirs. Comprendre la mémoire des enfants est d’un grand intérêt pour déchiffrer celle des adultes. La mémoire d’un enfant se construit au fil du temps, mais alors qu’on devrait s’émerveiller de la rapidité avec laquelle il maîtrise en grandissant, la mémoire des gestes (mémoire procédurale), des concepts (mémoire sémantique) et des mots (langage), l’adulte qu’il sera devenu s’inquiètera un jour de l’absence de souvenirs de sa petite enfance. Les souvenirs correspondent à une autre forme de mémoire, dite mémoire épisodique, qui nous permet de nous rappeler les moments vécus une fois, précisément datés et localisés, et en outre teintés d’émotion.
Et pourtant, in utero…
Les dernières semaines de grossesse montrent une capacité pour le fœtus de mémoriser quelques informations. Pour savoir que le nourrisson se rappelle les informations enregistrées lorsqu’il était fœtus, les chercheurs analysent les réactions de succion rapide ou d’orientation du regard.
C’est ainsi qu’un fœtus mémorise une mélodie grave (le basson de Pierre et le Loup) ou la voix de sa mère, s’il les a entendues plusieurs fois au cours des six dernières semaines de grossesse. Deux jours après sa naissance, il sucera plus intensément sa tétine en entendant cette mélodie ou la voix de sa mère. Un nourrisson dont la mère a résidé près d’un aéroport pendant sa grossesse ne se réveillera pas au passage d’un avion. Des nouveau-nés de quatre jours préfèrent, entre différentes odeurs, celle de l’anis consommé par leur mère en fin de grossesse. Un nourrisson se souvient d’objets, de personnes, de gestes ou d’événements vus quelques jours ou quelques semaines auparavant. Il identifie très rapidement la voix, le visage et l’odeur de sa mère. Aucune trace n’en demeurera à l’âge adulte. Faut-il s’en inquiéter, s’en réjouir ou s’en étonner ?
La durée de conservation d’un souvenir augmente avec l’âge de l’enfant
Une expérience assez astucieuse a été réalisée par Carolyn Rovee-Collier. Les mouvements spontanés des pieds de différents nourrissons ont tout d’abord été comptés, puis de nouveau après qu’un ruban relié à un mobile au-dessus du berceau ait été attaché à leur pied, enfin, on a mesuré à partir de quand les bébés n’agitaient plus leur pied lorsque le mobile était placé sans ruban au-dessus d’eux. On a ainsi constaté qu’un nourrisson de 3 mois se souvenait de ce jeu pendant une semaine ; un bébé de 6 mois pendant deux à trois semaines ; et un enfant de 18 mois pendant trois mois. La durée de la trace mnésique s’allongeait en cas de réapprentissage : ainsi, à 3 mois, une réactivation une semaine plus tard prolongeait jusqu’à six semaines le souvenir du mobile.
Ce n’est qu’à partir de 2 ou 3 ans, et souvent quelques années plus tard, que les souvenirs peuvent être conservés pour quasiment toute la vie. L’âge des premiers souvenirs varie en fonction du sexe : au mieux 2 ans et demi pour les garçons, mais 2 ans pour les filles à qui leur mère parle davantage, or, en racontant sa journée à la crèche ou à l’école, la petite fille vit sa journée une seconde fois, ce qui l’ancre davantage dans sa mémoire épisodique. À une époque, la culture intervenait aussi : en Occident, la moyenne se situait entre 3 et 5 ans, alors qu’elle était de 7 à 9 ans en Asie, où les mères parlaient moins de leur petite enfance à leurs enfants.
Certains sont persuadés qu’ils se rappellent d’événements antérieurs à cette barrière de 2 ans, mais ce sont presque toujours des souvenirs reconstruits à partir de récits, de photos ou de films. Aucune personne n’est en mesure de se rappeler sa naissance… Fort heureusement !
Pourquoi cette barrière ?
En fait, l’amnésie infantile n’est pas immédiate puisque jusqu’à 7 ans, les enfants se souviennent d’environ les deux tiers des évènements vécus avant 3 ans, alors que vers 8 ans, à peine un tiers est rappelé. Si une évocation pas trop tardive des souvenirs les retrouve, par la suite, ils sont de moins en moins accessibles et leur trace disparaît. Comment expliquer que des souvenirs soient retenus par des enfants pendant quelques mois ou quelques années pour être ensuite oubliés ?
Pendant longtemps, les psychanalystes ont cru à l’existence d’un refoulement à l’origine de l’amnésie infantile. L’explication est plus neurobiologique. Très logiquement, en raison de sa grande complexité, le cerveau humain n’atteint pas immédiatement sa pleine maturité biologique. Les systèmes hippocampiques d’apprentissage des épisodes vécus manquent de la maturité nécessaire à leur conservation à long terme. On peut aussi penser que les indices temporels et spatiaux du souvenir se fragilisent au fil du temps. Autre explication, la mémoire des souvenirs personnels est en grande partie construite sur le langage et ce n’est pas un hasard si les premiers souvenirs remontent au moment où l’expression orale se développe. Si l’amnésie infantile est parfois plus longue, un enfant peut néanmoins construire pendant cette période des souvenirs flashes quasiment photographiques d’évènements fortement émotionnels. À l’inverse, un choc émotionnel particulier, tel le décès d’un parent, peut faire oublier ce qui s’est passé les années auparavant.
Dernier point et pas des moindres, avant l’âge de 7-8 ans, un enfant croit sa mémoire infinie et invulnérable, au point qu’il ne sait même pas qu’elle existe : son fonctionnement ne l’intéresse pas, il ne fait aucun effort pour développer des stratégies de mémorisation, car il ne doute pas de ses capacités. Paradoxalement, murir, c’est douter de sa propre mémoire et donc mettre en place des stratégies qui aideront l’enfant à mieux connaître et comprendre sa mémoire. Sans perception de l’oubli, impossible de saisir l’intérêt de bien apprendre.
Est-il si important de se rappeler sa première fessée ?
Ce n’est pas parce que les adultes ont de faibles souvenirs d’enfance que leur mémoire est de mauvaise qualité. Alors que les premiers temps de la vie sont marqués par une prodigieuse accumulation d’apprentissages des gestes et des savoirs, pourquoi l’absence de souvenirs de la petite enfance génère-t-elle autant d’inquiétude ? Sans doute parce qu’elle réveille chez l’adulte une faille dans son identité, qu’elle active le sentiment désagréable que son passé lui échappe pour partie.
Source : Pour en savoir plus : Bernard Croisile. Tout sur la mémoire. Éditions Odile Jacob (2009).