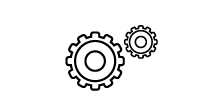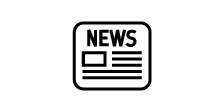Peut-on transférer des souvenirs d'un être vivant à un autre ?
 « Je m’attends à beaucoup d’étonnement et de scepticisme » a déclaré L. Glanzman au sujet de l’étude que nous allons vous relater ici. Lui et ses collègues de l’Université de Californie à Los Angeles sont en effet parvenus à transférer les souvenirs d’un escargot de mer à un autre. Or, leur expérience remet en question une conception de la mémoire qui faisait assez peu débat jusqu’à présent dans la communauté (neuro)scientifique. Découvrons pourquoi ce transfert de mémoire réalisé chez des mollusques doit être abordé avec précaution.
« Je m’attends à beaucoup d’étonnement et de scepticisme » a déclaré L. Glanzman au sujet de l’étude que nous allons vous relater ici. Lui et ses collègues de l’Université de Californie à Los Angeles sont en effet parvenus à transférer les souvenirs d’un escargot de mer à un autre. Or, leur expérience remet en question une conception de la mémoire qui faisait assez peu débat jusqu’à présent dans la communauté (neuro)scientifique. Découvrons pourquoi ce transfert de mémoire réalisé chez des mollusques doit être abordé avec précaution.Avant d’en venir aux modalités concrètes de cette expérience et au débat qu’elle suscite, il convient de préciser que la recherche menée par David Glanzman se concentre sur l’étude de l’engramme, cette trace biologique de la mémoire dans le cerveau. Actuellement, il est très largement admis que l’enregistrement des souvenirs dans la mémoire à long terme se réalise grâce à un renforcement des connexions, ou des synapses, entre les groupes de neurones qui participent à l’encodage des expériences vécues. Par ailleurs, de récents travaux réalisés avec des mollusques marins ont montré que, chez ces espèces, la mémoire à long terme pouvait être rétablie après une amnésie ; cela grâce un processus faisant intervenir l’acide ribonucléique (ARN). Il s’agit d’une molécule présente chez pratiquement tous les êtres vivants et qui est un composant important dans la formation des souvenirs à long terme.
Pour leur expérience, les scientifiques ont « entraîné » des escargots de mer (Aplysia californica) de la sorte : ils leur ont administré de légers chocs électriques pour déclencher chez ces mollusques gastéropodes un geste réflexe, la rétractation de la queue. Preuve que ce « conditionnement » (certes, pas des plus agréables pour l’animal) fonctionnait : à la première électrocution, la contraction durait environ une seconde, alors qu’après une dizaine d’autres stimulations électriques, elle durait presque 50 secondes. Comme si l’escargot de mer avait « appris » à se défendre. Ensuite, les chercheurs ont prélevé de l’acide ribonucléique dans le système nerveux des mollusques « sensibilisés » et l’ont injecté à 7 congénères « novices ».
Que s’est-il passé chez les individus de ce groupe ? Bien que non « conditionnés », ils ont réagi de manière presque similaire aux stimulations électriques, puisqu’ils ont montré une contraction défensive de la queue qui a duré en moyenne 40 secondes. « C’est comme si nous avions transféré la mémoire ! », a déclaré avec enthousiasme D. Glanzman. Son équipe a également observé que l’ARN extrait d’escargots « entraînés » augmentait l’excitabilité de neurones sensoriels (cultivés dans des boîtes de Pétri) provenant d’escargots n’ayant jamais subi de chocs électriques.
D. Glanzman et ses collègues savent que leur étude remet en question le fait que les souvenirs sont stockés dans les synapses. Pour ces scientifiques, c’est plutôt dans le noyau des neurones (où est synthétisé l’ARN) que le stockage s’effectue. L’ARN indiquerait à l’ADN quels gènes activer et désactiver, et ce serait donc ces modifications dites « épigénétiques » qui seraient responsables du stockage des souvenirs. Les auteurs précisent également que l’escargot marin est un excellent modèle pour l’étude du cerveau et de la mémoire, parce que les processus cellulaires et moléculaires semblent être très proches entre ce gastéropode et l’homme (même si le premier compte environ 20 000 neurones dans son système nerveux central et que le second en aurait environ 100 milliards).
C’est ainsi que D. Glanzman n’hésite pas à évoquer sérieusement la transposition de cette expérience chez l’homme : « dans un avenir proche, nous pourrions utiliser l’ARN pour éveiller et restaurer des souvenirs qui sont devenus dormants lors des premiers stades de la maladie d’Alzheimer ». Pour l’heure, et pour faire preuve d’une grande prudence scientifique, il s’agirait plutôt d’inviter des chercheurs à mener des études similaires qui viendraient renforcer ou, au contraire, freiner l’enthousiasme de ce chercheur.
Source : Bédécarrats A., Chen S. , Pearce K, Cai D., Glanzman D. RNA from Trained Aplysia Can Induce an Epigenetic Engram for LongTerm Sensitization in Untrained Aplysia, in eNeuron, mai 2018